Entretien avec Frédérique Latu
Avec 35 équipes artistiques invitées dans 25 lieux différents pour 50 rendez-vous dont la moitié sont des créations sur un mois, Les Rencontres Internationales de Seine-Saint-Denis voient grand ! Frédérique Latu nous en livre ses secrets.
DCH : Quel est le secret d’une édition aussi copieuse alors que les temps sont plutôt difficiles, économiquement parlant ?
 Frédérique Latu : Oui, c’est une programmation copieuse, nous nous en réjouissons. Nous avons réussi à mobiliser de nombreux partenaires, des financements multiples et nous nous inscrivons dans le cadre de tournées internationales. C’est un travail à part entière de combiner tous ces aspects pour monter le festival. Et puis, nous avons un ADN très activiste aux Rencontres qui consiste à penser : les temps sont durs, le climat est tendu, mais nous allons concentrer tous les moyens que nous pouvons trouver pour faire en sorte que ce festival existe dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, dans tout ce que nous avons envie de porter en termes de valeurs artistique, éthique, et même politique. Il faut, je crois, donner des signes forts de soutien aux équipes artistiques qui ne sont pas des plus sereines aujourd’hui. En 2023, nous avons donné plus de 160 représentations dans cinquante lieux différents ce qui fait de nous l’un des plus importants opérateurs de danse d’Île-de-France.
Frédérique Latu : Oui, c’est une programmation copieuse, nous nous en réjouissons. Nous avons réussi à mobiliser de nombreux partenaires, des financements multiples et nous nous inscrivons dans le cadre de tournées internationales. C’est un travail à part entière de combiner tous ces aspects pour monter le festival. Et puis, nous avons un ADN très activiste aux Rencontres qui consiste à penser : les temps sont durs, le climat est tendu, mais nous allons concentrer tous les moyens que nous pouvons trouver pour faire en sorte que ce festival existe dans toutes ses dimensions, dans toutes ses facettes, dans tout ce que nous avons envie de porter en termes de valeurs artistique, éthique, et même politique. Il faut, je crois, donner des signes forts de soutien aux équipes artistiques qui ne sont pas des plus sereines aujourd’hui. En 2023, nous avons donné plus de 160 représentations dans cinquante lieux différents ce qui fait de nous l’un des plus importants opérateurs de danse d’Île-de-France.
DCH : Quelle est la couleur de ces Rencontres 2024 ?
Frédérique Latu : Cette édition met l’accent sur les créations et la diversité chorégraphique avec de jeunes générations et des artistes plus confirmés. Ce foisonnement permet la vitalité, le renouvellement, et donne une couleur très en phase avec l’actualité de la danse. Ce festival 2024 est à l’image du ton que nous voulons donner, avec les artistes, les lieux partenaires qui sont très mobilisés et engagés. C’est également une programmation en lien avec tous les axes que nous avons travaillé au cours des trois dernières années. Nous avons en effet continué d’investir différents territoires artistiques et géographiques, ouvert d’autres moments festivaliers répartis dans l’année, que sont Playground (un temps fort jeune public) ou Boost (un temps fort hip-hop). Donc tant avec la question de la jeunesse que des cultures urbaines. L’idée étant que les Rencontres Chorégraphiques Internationales restent le cœur et le phare de notre projet, nous faisons le lien avec ces nouvelles pistes de travail. Nous retrouvons ainsi dans cette édition des propositions familiales telle Valse avec W de Marc Lacourt et des spectacles dans les espaces publics qui se veulent accessibles aux habitants de Seine-Saint-Denis, comme Pol Jiménez dans un petit parc à Montreuil ou notre partenariat avec le CN D pour Un kilomètre de danse. Ces propositions font également le lien avec les « Extensions » qui arrivent ensuite. Tout cela se couple à notre désir de maintenir une dimension internationale forte, qui, pour des raisons économiques, comme écologiques, est plus compliquée aujourd’hui. Néanmoins, les artistes étrangers représentent toujours 60% de notre programmation.
DCH : Comment choisissez-vous les artistes que vous programmez dans ce festival ?
Frédérique Latu : Notre ambition est une démarche très affirmée, voire radicale et nous avons la chance d’avoir des partenaires très différents. De la MC 93 de Bobigny qui peut accueillir les 60 interprètes de Drumming XXL d’Anne Teresa De Keersmaeker et Clinton Stringer dans une version exceptionnelle avec les danseurs de l’Ecole des Sables de Germaine Acogny à Toubab Dialow, à l’Echangeur de Bagnolet ou les Laboratoires d’Aubervilliers qui peuvent supporter des projets plus confidentiels avec leur jauge de cent places. A chaque fois l’idée étant de trouver des pièces en résonance avec les espaces pour permettre cette rencontre entre les œuvres, le contexte et le public. Donc de s'autoriser de grands écarts! Il est capital de pouvoir aussi proposer des formats généreux qui transmettraient ce plaisir de la danse à des spectateurs qui viendraient pour la première fois, d’où Hatched Ensemble de Mamela Nyamza en ouverture, un spectacle magnifique en provenance d’Afrique du Sud avec dix danseuses, une chanteuse d’opéra et un musicien ou les vingt danseurs autodidactes pleins de singularités de Témoin de Saïdo Lelouh.

DCH : Avez-vous un axe particulier ?
Frédérique Latu : Je ne travaille pas à partir de thématiques ou d’axes de réflexion a priori, mais plutôt de manière empirique, en conjuguant le panel des lieux partenaires, et l’envie de donner de la visibilité à des artistes peu ou pas assez vus. J’aime aussi que les pièces puissent faire débat. Certes, je cherche à fédérer autour du festival, mais l’enjeu n’est pas de produire des pièces consensuelles. C’est de présenter des pièces extrêmement tenues, très engagées, qui puissent être fortement interrogées sur leur forme pour permettre un échange critique riche et à toutes les subjectivités de se retrouver et se confronter. J’aime également les propositions très poreuses aux défis du moment, en prise avec les questions esthétiques, artistiques, mais aussi aux thèmes qui traversent notre société. Par exemple, il y a un fil rouge qui s’est imposé et nous parle de la vulnérabilité de l’existence, de la perte, du deuil que l’on peut retrouver dans After All de Solène Weinachter, La Rose de Jericho de Magda Kachouche, Insel de Ginevra Panzetti et Enrico Ticconi, ou About love and death… élégie pour Raimund Hoghe d’Emmanuel Eggermont.

Il y a aussi tout un parcours autour de la décolonisation, avec Histoire(s) Décoloniale(s)# Mulunesh de Betty Tchomanga, Mamela Nyamza, Smaïl Kanouté avec Bala Funk, ou encore d’artistes qui refusent les assignations comme Mallika Taneja, Lukas Avendaño ou Bruno Freire. Ce sont des notions importantes à défendre, d’autant plus en Seine-Saint-Denis où nous avons la chance d’avoir une pluralité de population de toutes nationalités, une jeunesse bouillonnante, et où la question de se réapproprier ses propres identités, ses propres cultures sans subir celles qui sont imposées de l’extérieur est si brûlante. Nous devons défendre la multiplicité de points de vue, chacun étant légitime à choisir son propre chemin. Mais on peut aussi suivre d’autres parcours. Comme le fil de l’écriture chorégraphique versus un travail plus performatif… De Gaëlle Bourges et sa création Juste Camille, à Anne Teresa De Keersmaeker, de Bruno Freire et sa création MATAMATÀ au carrefour de la danse, du théâtre, de la littérature et des arts visuels à Témoin de Saïdo Lehlouh. On pourrait même trouver une ligne « Ballets russes » avec Lo Faunal (Le Faune) de Pol Jiménez, ou Emmanuel Eggermont qui reprend quelques extraits du Faune de Raimund Hoghe… Bref, le spectateur peut imaginer son propre trajet.

DCH : Comment le public de Seine-Saint-Denis perçoit-il les Rencontres ?
Frédérique Latu : Quand je suis arrivée en 2021, il s’agissait de renforcer l’ancrage du festival en Seine-Saint-Denis en lien avec ses habitants et habitantes, particulièrement après le Covid et la fermeture des salles de spectacles. Il fallait tenir un double objectif, préserver ce qui faisait des Rencontres un rendez-vous incontournable pour la communauté chorégraphique dans son ensemble, et renforcer la présence de la danse en proximité avec les habitants. Ce qui était déjà en place mais que nous voulions accentuer, augmenter, sur les projets que nous menons tout au long de l’année. D’où la création d’événements aux temporalités différentes, comme Playground ou Boost, qui a lieu juste avant comme un prologue aux Rencontres et permet de mutualiser les forces pour faire en sorte que le public vienne voir, découvrir, apprécier. Le festival s’appelle Rencontres chorégraphiques et le mot rencontre est primordial. Je suis très heureuse de partager cette édition avec les artistes, le public, les habitants et les professionnels puisque nous avons également choisi de programmer plusieurs journées professionnelles, des rencontres avec les publics, ou encore une formation pour les enseignants.
DCH : Vous avez de très nombreux lieux partenaires, comment s’insèrent-ils dans Les Rencontres ?
Frédérique Latu : Les lieux partenaires sont très importants pour nous et je les remercie de leur confiance et soutien. Les Rencontres Chorégraphiques, pour un certain nombre d’entre eux, est aussi l’endroit où ils peuvent prendre des risques supplémentaires par rapport à leur saison. Parce que nous travaillons en coopération et que nous portons les propositions ensemble, c’est aussi un espace de liberté que nous nous accordons mutuellement.
Propos recueillis par Agnès Izrine avril 2024
Les Rencontres chorégraphiques Internationale de Seine-Saint-Denis du 13 mai au 15 juin 2024

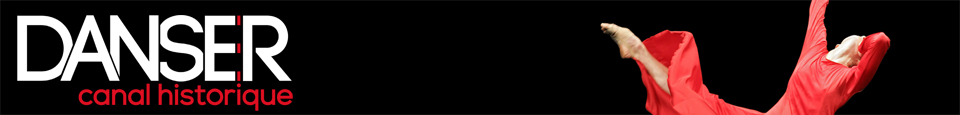













Add new comment