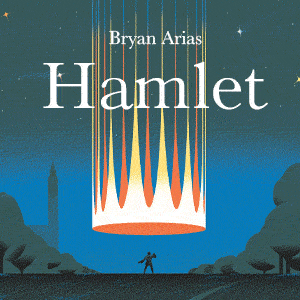« IDA don’t cry me love » de Lara Barsacq
Particulièrement en vue, la recherche de Lara Barsacq tente d’articuler la grande histoire de la danse et la petite histoire personnelle. Mais c’est au risque de tomber dans la convention des spectacles à la mode à force de ne retenir du passé que ce qui sert la satisfaction autobiographique.
Cet IDA don’t cry me love de Lara Barsacq constitue le second volet d’une recherche à forte coloration autobiographique que la chorégraphe a engagée avec Lost in ballets russes (2018). Après un parcours professionnel brillant (Batsheva et Ballets C de la B., entre autres), elle explore sa légende familiale - insistant beaucoup sur son lien avec son arrière grand-oncle, Léon Bakst — et pour ce second épisode, s’attache à la figure d’Ida Rubinstein dont une affiche de spectacle ornait la cuisine familiale. Projet intéressant qui n’est pas sans lien, dans une logique de danse documentaire, avec ce qu’avait tenté, pour un succès mitigé, Olga de Soto avec Histoire(s) (2004) consacré au Jeune Homme et la Mort de Roland Petit, mais où la recherche sur l’histoire de la danse se teinte d’expériences personnelles, et réciproquement, dans une logique assez à la mode.

Quand le public entre dans la salle, elles sont trois, déjà au plateau. En fond de scène, une grande toile, un genre de patchwork plus ou moins obscur, mais qui renforce la sensation de tréteaux et de saltimbanques. À l’avant-scène, côté jardin deux des trois interprètes commencent à déshabiller la troisième qui se couvre de paillettes après s’être ointe d’une substance huileuse. Cela aide les paillettes à adhérer. Puis elle enfile un genre de coiffe tenant de l’aile argentée et de la parure d’indien, tandis qu’une voix off annonce « hommage à Ida Rubinstein ».
La pièce se développe alors par successions de saynètes dansées à trois, comme une frise, un jeu ou une cérémonie, entremêlées de moment discursifs consacrés à la personnalité d’Ida Rubinstein et d’autres à tonalité très autobiographique où les trois interprètes confient leurs souvenirs (sentimentaux en particulier) avant de se livrer à de plaisantes facéties à base de caisse claire ou de guitare pour quelques improvisations chantantes trop incertaines pour être prises au sérieux.

S’entrelacent les soli, dans un style néo-danse-libre-art-décoratif, avec poses et mains dessinant le triangle pubien ; le tout avec une manière de sérieux tout de componction faussement affectée. C’est plutôt drôle et se suit avec plaisir dans l’ironie et la distance. Certes, cela joue très faux le texte que les interprètes s’efforcent d’animer, mais cet effet fait partie du genre ; c’est un peu décousu avec de sérieuses baisses de rythme, mais l’abattage des interprètes aide l’affaire à passer ; les points de vue exprimés biaisent assez avec les faits historiques. Ne citer le nom de Diaghilev qu’à la moitié du spectacle et pour une très anecdotique histoire de léopard apprivoisé (pour précision, et contrairement à ce que dit le spectacle, le fauve était un guépard, les léopards ne s’apprivoisent jamais), relève d’une intention de révision de l’histoire un rien pesante. Mais après tout, l’ensemble est plaisant, plutôt blagueur et léger.
La gêne s’instille cependant au fur et à mesure que s’enchaînent les éléments de récit autour de la figure d’Ida Rubinstein. Arrive cependant un moment où l’hagiographie pousse un peu loin le bouchon : tout cela donne l’impression que la danseuse serait donc ce génie ayant révolutionné l’art de la scène et qui provoquait la société pour affirmer son art…
Certes, elle mime nue la Danse des Sept voiles, mais dans un contexte où les figures du demi-monde s’affichent dans des pantomimes plutôt lestes avec le soutien des plus éminents artistes. La grande Mariquita ou le célèbre mime Georges Wague mettent en scène Cléo de Mérode, Polaire ou Colette à demi-nues sans que cela constitue la manifestation d’une rébellion dans le climat érotico-orientalisant du début du siècle (que l’on se souvienne du succès de Mata-Hari), ni de confusion entre le grand et le demi-monde que déplorent certaines grandes familles (d’où la réaction de celle d’Ida).
Mais il est gênant d’entendre que cela relève d’une posture esthétique avant-gardiste comme il est mal venu de laisser croire qu’elle est l’auteur des nombreuses œuvres qu’elle commande pour se mettre en valeur. Il est encore plus gênant d’à peine citer les chorégraphes qui la font travailler malgré des dispositions pour la danse limitées. Venir prétendre que sa danse particulièrement originale en est la raison, revient à confondre l’affichage d’un corps, certes différent des codes en vigueur, avec une démarche artistique : c’est prendre Rubinstein pour Isadora Duncan quand elle répondrait plutôt à une Kim Kardashian qui serait distinguée…

Quant à la poser pour une rebelle, cela témoigne d’un sens assez altéré des réalités sociales ; il ne faut pas confondre l’écrivain Gabriele D'Annunzio et le révolutionnaire Kropotkine, le dandysme décadent avec une rébellion sociale. Rubinstein appartenait à cette tendance qui voit de riches héritiers, on peut penser à Raymond Roussel, consacrer leur fortune aux délices esthétisants. Elle était riche, usait de sa fortune à son gré avec infiniment plus de réussite, de talent et beaucoup plus de lucidité qu’une Florence Foster Jenkins se prenant pour une cantatrice, mais il n’y a pas de différence de fond. Si les mots ont un sens, Ida Rubinstein n’a jamais été un mécène (pas plus que Diaghilev au demeurant, mais c’est parce qu’il n’avait pas d’argent) en ce qu’elle n’aidait pas les artistes, mais les faisait travailler pour elle. La lecture du livre de Marcel Marnat sur Ravel témoigne assez clairement des relations que le compositeur entretient avec la danseuse et directrice de compagnie : elle lui a passé commande, il travaille, les choses sont dans l’ordre…
Et la dame qui arrive en Rolls aux répétitions se fiche comme de son premier sac Chanel (laquelle Mademoiselle fut une authentique mécène) du reste. « Là où les mensonges sont agréables, ils sont permis » écrit Nietzsche ; quand ils se voient trop, ils cessent d’être agréables… A trop vouloir faire de Rubinstein une héroïne queer, justifiant la contestation du genre, la pièce pèse par sa convention au regard des spectacles dans l’air du temps. Et rendre hommage à l’originalité d’Ida Rubinstein en se satisfaisant d’une approche conventionnelle relève un peu du contre-sens ! Dommage.
Philippe Verrièle
Vu à Montreuil, Nouveau théâtre, le 16 octobre, dans le cadre des Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis.
Catégories: