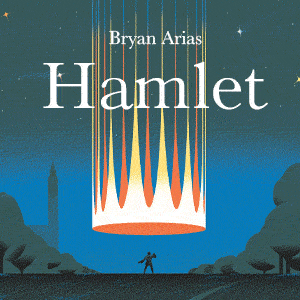Roderick George l kNoname Artist : « The Grave’s Tears »
Le chorégraphe et danseur américain Roderick George et son collectif kNoname Artist présente une création mondiale The Grave’s Tears (Les larmes du tombeau), en ouverture du festival Born to be a live au Manège, Scène nationale de Reims. Une pièce tout en contrastes.
Dans une lumière crépusculaire, les sept interprètes, dont Roderick George, s’élancent, d’une manière qui signe le ballet classique, sur la musique langoureuse de Diana Ross Ain't No Mountain High Enough. Il faut dire que Roderick George sait de quoi il parle, lui à qui l’on a prédit qu’il ne serait jamais danseur à cause de sa taille et qui, après la médaille de bronze du prestigieux Youth America Grand Prix, a travaillé dans les plus grandes compagnies, à commencer par celle William Forsythe, le Cedar Lake Contemporary Ballet, le Ballet de Bâle, ou le Göteborgs Operans Dans Kompany. Mais ici, la chanson fait moins référence à la danse qu’à son identité et à la résilience nécessaire face à la maladie. En tant qu’homme noir et queer, originaire du Texas, Roderick George puise dans sa propre histoire pour rendre hommage à celles et ceux qui ont lutté pour la dignité et la reconnaissance de leur personne dans les communautés noires et homosexuelles new-yorkaises, et plus généralement encore, de toutes les minorités.

Sur le plateau recouvert de cendres, ou de résidus de plastique, sous les éclats d’une boule à facettes, The Grave’s Tears ouvre donc le festival Born to be a live et livre une fresque chorégraphique poignante qui revisite les années 1980 à New York, au cœur de l’épidémie de sida, convoquant l’effervescence des clubs queers, lieux de fête et de résistance, tout en retraçant les ravages de la maladie sur les corps racisés et marginalisés. Il faut bien avouer que dans l’Amérique Trumpiste, le sujet revient en force, l’accès aux soins devenant toujours plus précaire.
 Mais ce qui nous étonne – et détonne – reste le vocabulaire utilisé, à savoir, un curieux mélange de classique, de néo classique et de jazz, qui, vu d’Europe, semble un peu inapproprié pour parler d’un tel sujet. En 1993, Still Here de Bill T. Jones – une des premières pièces à parler du sida et à exposer des malades sur scène – avait suscité chez nous les mêmes interrogations. Mais peut-être le chorégraphe fait-il « avec ce qu’il a » sous les pieds, à savoir une formation solide chez Alvin Ailey, Forsythe ou au Houston Ballet chevillée au corps…
Mais ce qui nous étonne – et détonne – reste le vocabulaire utilisé, à savoir, un curieux mélange de classique, de néo classique et de jazz, qui, vu d’Europe, semble un peu inapproprié pour parler d’un tel sujet. En 1993, Still Here de Bill T. Jones – une des premières pièces à parler du sida et à exposer des malades sur scène – avait suscité chez nous les mêmes interrogations. Mais peut-être le chorégraphe fait-il « avec ce qu’il a » sous les pieds, à savoir une formation solide chez Alvin Ailey, Forsythe ou au Houston Ballet chevillée au corps…
Mêlant sensualité et gravité, la pièce juxtapose donc maladie et énergie de la danse. Les déhanchés disco contrastent avec les visages fermés et les tenues flottantes, évoquant à la fois les limbes, les costumes de danse ou les chemises d’hôpital. Progressivement, la lumière se refroidit, les rythmes binaires cèdent la place au piano inquiet de Julius Eastman. Le groupe se désarticule : un bras se dérobe, un pied s’égare, les genoux tremblent. L’équilibre vacille, les portés deviennent chutes. La lutte contre la maladie s’incarne dans les corps, soutenue par des extraits du documentaire How to Survive a Plague de David France et la lecture d’un texte d’Alok Vaid-Menon, dénonçant l’inaction politique et la violence du silence.
Galerie photo © Vincent VDH
Dans la pénombre, traversée des lueurs d’incendie créées par les magnifiques éclairages de Tanja Rühl, des pas de deux bouleversants émergent alors, qui déploient toutes les figures du genre, bien que, tant dans la musique que dans les mouvements, il y ait un fort courant sous-jacent de tension et de puissance qui finit par faire surface de manière spectaculaire. Au fur et à mesure que The Grave’s Tears se développe, l'athlétisme des interprètes s’affirme, et un magnifique trio se déploie, en plus de solides sections à l'unisson. Mais le plus surprenant dans The Grave’s Tears reste que malgré cette débauche chorégraphique, nous saisissions une ambiance de fin du monde, que nous sentions s’immiscer la peur dans les bras qui s’élèvent, la mort dans les corps que l’on traîne, dans ces ensembles qui s’agrègent en masses désespérées. Le solo final d’Aram Hasler, d’une intensité rare, clôt la pièce sur une note de persistance : celle d’un mouvement qui continue, malgré tout. Avec The Grave’s Tears, Roderick George signe une œuvre de mémoire et de résistance, où la danse devient un cri d’amour face à l’effacement de la communauté LGBTQIA+.
Agnès Izrine
Vu le 4 novembre 2025 au Manège, Scène nationale de Reims dans le cadre du festival Born to be a live
Catégories: